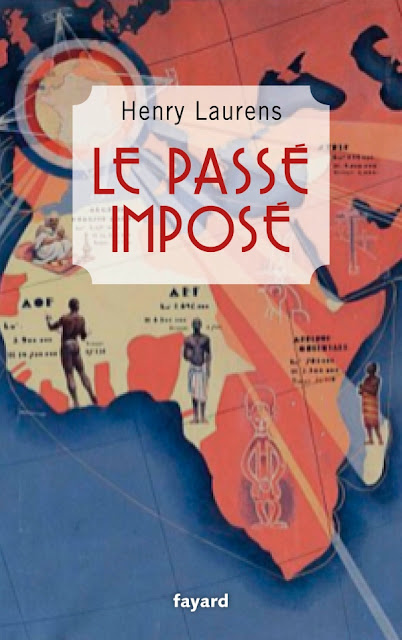Henry LAURENS, Le passé imposé, Fayard, Paris 2022, 253 pages.
Voici un ouvrage un peu curieux, dans lequel un historien chevronné, spécialiste des relations entre l’Orient et l’Occident, s’exprime sur certaines tendances actuelles dans l’écriture de l’Histoire. C’est donc un essai, que l’on aura du mal à rentrer dans une catégorie plus précise. Curieux, le plan, en quatre longs chapitres, l’est tout autant. Le premier d’entre eux est intitulé « prolégomènes ». On veut bien, mais il fait tout de même 74 pages, soit le quart du volume. Le dernier reprend le titre du livre, à moins que ce ne soit l’inverse. L’écriture, elle, est assez hachée, surtout au début. Bref, on se demande au bout d’un moment ce que l’on fait avec Le passé imposé entre les mains. Rassurons les lecteurs potentiels : cette sensation ne dure pas et l’intérêt se renforce au fil des pages. Le tout est de passer les (trop) longs prolégomènes, qui ne font que présenter quelques bases de la discipline, pour atteindre le corps du sujet du livre.
Le chapitre sur l’orientalisme et l’occidentalisme est l’occasion d’une discussion d’où il ressort que l’on connaît actuellement plutôt une grande convergence des sociétés, même si l’imposition de valeurs occidentales reste parfois mal acceptée. Celui sur les violences du dernier siècle est une réflexion sur des sociétés européennes qui se redécouvrent violentes en 14-18 après une longue période de paix. Henry Laurens rejette l’explication par la violence coloniale, trop limitée dans le temps et dans ses acteurs, pour avoir eu une influence sur la brutalisation des hommes en guerre. Cette violence paroxystique débouche sur sa négation à la fin du XXème siècle, moment où la victime remplace le héros dans l’imaginaire historique. Au passage, il souligne à juste titre combien l’attentat-suicide constitue comme une synthèse nihiliste de ces notions de héros et de victime. Son rappel des propos de Lénine sur la violence de classe passant par l’élimination de quelques milliers de personnes pour en terroriser bien davantage n’est pas sans écho dans l’Ukraine actuelle, où la formule de dénazification couvre une volonté de rattachement forcé à la mère-patrie russe. Le dernier chapitre, enfin, est une claire dénonciation des usages du passé pour se poser (ou poser tel ou tel groupe auquel on se rattache) en victime, comme cela se fait dans la lignée des « post-colonial studies » anglo-saxonnes, puis maintenant françaises. Laurens souligne combien la situation des migrants ou de leurs descendants actuels n’a que peu à voir avec la colonisation, mais bien plus avec la mondialisation économique et les mouvements migratoires qu’elle entretient. La confusion des deux explications ne sert que des entrepreneurs d’identité. La racialisation des rapports sociaux, au nom de « l’authenticité », et en fait de l’essentialisation des individus est une impasse dangereuse dans une société fracturée, qui doit apprendre à se considérer comme diverse et cependant unie.
La mémoire n’est décidément pas l’Histoire, et l’historien se doit d’admettre qu’il est dans sa vocation de déplaire à tout le monde. La démarche militante n’est pas la démarche historienne. Ce livre le rappelle utilement.
Jean-Philippe Coullomb