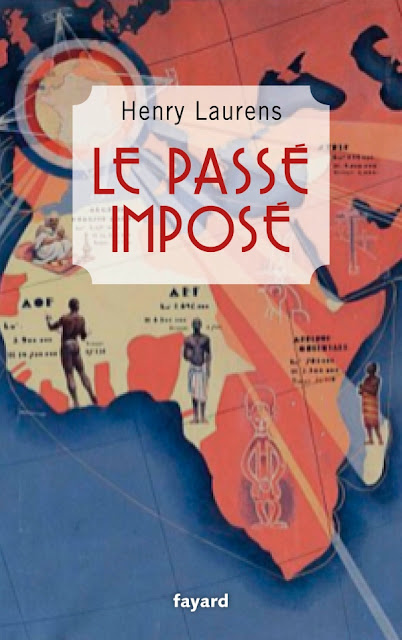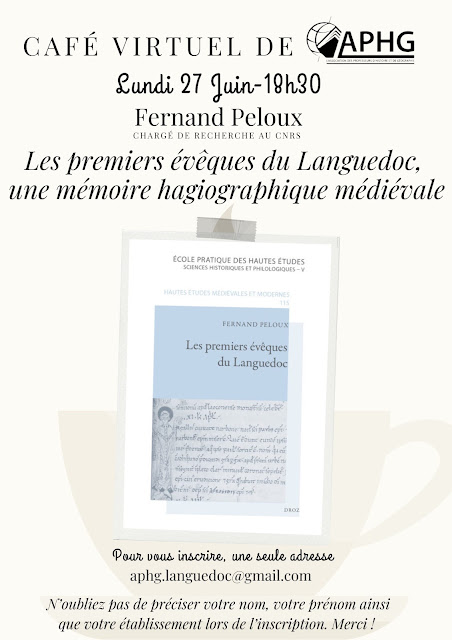Jean
LOPEZ, Kharkov
1942, le dernier désastre de l’Armée Rouge,
collection Champs de bataille, Perrin avec le Ministère des Armées,
Paris 2022, 316 pages.

Quand
on a un faible pour l’histoire militaire la plus classique, Jean
Lopez est une bonne pioche. Quand en plus il écrit sur une bataille
ayant eu lieu à proximité d’une ville dont on reparle à cause
d’une nouvelle guerre, en l’occurrence Kharkov, l’actuelle
Kharkiv ukrainienne, l’envie est trop forte et on cède à la
tentation d’acheter et de lire son dernier ouvrage. Disons-le,
l’éditeur, qui lance avec ce titre une nouvelle collection
d’histoire militaire (confiée justement à Jean Lopez), réalisée
en partenariat avec le Ministère des Armées, a fait du beau
travail. Les cartes en couleur, en encart central, sont agréables à
l’œil, lisibles et permettent de suivre correctement les
événements décrits dans le texte. Ordres de bataille, notes
infrapaginales, sources et bibliographie, index des noms de
personnes : tout y est. La qualité d’écriture, toujours
simple et percutante, participe aussi du plaisir de la lecture.
Sur
le fond, on a le récit d’une offensive soviétique ratée en mai
1942, lancée à partir d’un saillant dans le front allemand pour
envelopper et prendre Kharkov avant d’exploiter plus loin.
D’entrée, l’objectif semble surdimensionné pour les moyens
engagés, et isolée, une telle attaque n’aurait de toute façon pu
avoir que peu d’incidence stratégique sur le cours de la guerre.
Elle est déclenchée quelques jours avant que les Allemands ne
passent eux-mêmes à l’offensive pour cisailler à sa base le
susdit saillant. La manœuvre russe les oblige à anticiper quelque
peu leur propre manœuvre, mais aboutit finalement à la rendre plus
destructrice encore que ce à quoi elle aurait pu prétendre.
Timochenko, en particulier, s’acharne à ordonner d’attaquer au
fond du saillant alors même qu’il est en voie d’être sectionné
à sa base par les chars de Kleist. On saura gré à l’auteur
d’avoir utilisé les souvenirs d’un sergent soviétique, qui
raconte de l’intérieur, au ras du sol, la fuite et la survie dans
un de ces chaudrons terrifiants qui a marqué la guerre à l’Est.
Le bilan est éloquent, avec environ un quart de million d’hommes
perdus, un matériel immense détruit ou abandonné par l’Armée
Rouge, contre 20.000 hommes perdus pour la Wehrmacht.
Coincée
entre Barbarossa et Stalingrad, moins symbolique que le siège
meurtrier de Sébastopol, cette bataille pour Kharkov, la troisième
de la guerre, reste une grande oubliée des mémoires du conflit.
Elle n’est évoquée que dans les mémoires des chefs russes y
ayant participé, et qui cherchent surtout à se défausser de leurs
responsabilités sur leurs camarades ou leurs supérieurs. Elle est
pourtant riche d’enseignements auxquels l’actualité donne un
écho particulier. La sous-estimation de l’adversaire par le haut
commandement et la direction politique russes, nourrie par une
surévaluation sidérante des pertes qu’il a subies (Staline les
croit six fois plus élevées que la réalité !) semblent
sorties des émissions actuelles sur la guerre en Ukraine. La terreur
devant un chef que l’on n’ose contredire n’est pas sans
rappeler cette scène surréaliste du patron du FSB bredouillant
devant Vladimir Poutine.
Si
la bataille fut une lourde défaite pour les Soviétiques, on aura
compris que ce livre est belle une réussite, et on se dit que l’on
risque de revenir à cette nouvelle collection. Les prochains titres
annoncés portent sur Verdun et Crécy.
Jean-Philippe Coullomb